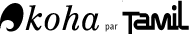Épiméthée [Texte électronique]
Language: français.Country: France.Publication: [Paris] : [6 av. Reille ; 75685 Cedex 14], Presses universitaires de France, [201.?]-ISSN: 2431-7373.Dewey: 105, 23Classification: 100Abstract: Cette collection se développe autour de trois axes : la traduction de grands textes philosophiques ; la publication d'essais d'histoire de la philosophie, enfin, l'accès à des recherches sur la rationalité contemporaine. La collection « Épiméthée » fut fondée en 1953 par Jean Hyppolite, lecteur et traducteur de Hegel, grand universitaire (directeur de l'École normale supérieure, professeur au Collège de France), qui la dirigea jusqu'à sa mort en 1968. Pourquoi le nom d'Épiméthée ? On peut deviner qu'Hyppolite entendait ainsi précisément ne pas privilégier celui de Prométhée, son frère plus célèbre. Et ce choix signifiait beaucoup, à un époque où les idéologies et les « grands récits » se disputaient la maîtrise des idées et des choses. Épiméthée, nous dit Platon, « n'était pas précisément un sage » : n'avait-il pas, lors de la distribution des dons aux races mortelles, oublié rien de moins que l'homme ? Prométhée donna « la sagesse qui sait y faire » - pourquoi donc philosopher sous l'égide d'Épiméthée, qui « demeure dans l'aporie » (Protagoras, col. 321) ? Parce que la philosophie – qui commence avec l'étonnement stupéfait devant la merveille que l'étant est – ne persiste que confrontée à des apories, arc-boutée sur elles et sans cesse relancée par leurs défis. L'aporie n'empêche pas la philosophie, mais la rend possible – et la philosophie s'assoupit dès qu'elle l'oublie. Par quoi seulement elle se distingue des sciences, toujours déjà situées dans les étants et assurées par leurs méthodes. En retrait de leur pensée prométhéenne, qui s'exténue de victoires et s'affole de raisons, Épiméthée, aporétique, lent et circonspect, pourrait donc bien, à la fin, offrir le seul nom convenable et sérieux à la philosophie dans les temps où s'accomplit la métaphysique. Comment une collection de philosophie pouvait-elle relever ce nom ? En respectant trois principes. Premièrement, lire (donc parfois éditer, toujours traduire, annoter, commenter) les grands textes de l'histoire de la philosophie, en privilégiant, à chaque époque, les lignes de force qu'imposent le mouvement de la recherche (par exemple, l'étude de Husserl) ou les lacunes de l'édition (ainsi les textes médiévaux, l'idéalisme allemand, les origines de la philosophie analytique). Deuxièmement, accueillir, au-delà de toute préférence personnelle, les ouvrages représentatifs de la philosophie telle qu'elle se fait sérieusement dans la communauté philosophique (depuis la philosophie de la logique, des mathématiques et des sciences, jusqu'aux frontières de l'esthétique et de la théologie) ; d'où la publication de grandes thèses, qui font époque, comme aussi de recueils thématiques, demandés à des chercheurs confirmés ; voire parfois des ouvrages collectifs (actes de colloques, hommages, etc.), pourvu qu'ils marquent un événement théorique. Troisièmement, la confiance lucidement faite à de jeunes penseurs, dont on devine qu'ils deviendront des classiques (car Hyppolite avait su repérer les premiers livres de J. Derrida, G. Deleuze, M. Henry et quelques autres). (fre).Online Resources:Click here to access online| Item type | Current library | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Périodique | Bibliothèque Tamil Général Stacks | 105 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 1070720 |
Browsing Bibliothèque Tamil shelves, Shelving location: Général Stacks Close shelf browser (Hides shelf browser)
Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2015-11-25
Titre provenant de l'écran-titre
Directeur de collection : Jean-Luc Marion
Collection
Editeur (20151125) Cette collection se développe autour de trois axes : la traduction de grands textes philosophiques ; la publication d'essais d'histoire de la philosophie, enfin, l'accès à des recherches sur la rationalité contemporaine. La collection « Épiméthée » fut fondée en 1953 par Jean Hyppolite, lecteur et traducteur de Hegel, grand universitaire (directeur de l'École normale supérieure, professeur au Collège de France), qui la dirigea jusqu'à sa mort en 1968. Pourquoi le nom d'Épiméthée ? On peut deviner qu'Hyppolite entendait ainsi précisément ne pas privilégier celui de Prométhée, son frère plus célèbre. Et ce choix signifiait beaucoup, à un époque où les idéologies et les « grands récits » se disputaient la maîtrise des idées et des choses. Épiméthée, nous dit Platon, « n'était pas précisément un sage » : n'avait-il pas, lors de la distribution des dons aux races mortelles, oublié rien de moins que l'homme ? Prométhée donna « la sagesse qui sait y faire » - pourquoi donc philosopher sous l'égide d'Épiméthée, qui « demeure dans l'aporie » (Protagoras, col. 321) ? Parce que la philosophie – qui commence avec l'étonnement stupéfait devant la merveille que l'étant est – ne persiste que confrontée à des apories, arc-boutée sur elles et sans cesse relancée par leurs défis. L'aporie n'empêche pas la philosophie, mais la rend possible – et la philosophie s'assoupit dès qu'elle l'oublie. Par quoi seulement elle se distingue des sciences, toujours déjà situées dans les étants et assurées par leurs méthodes. En retrait de leur pensée prométhéenne, qui s'exténue de victoires et s'affole de raisons, Épiméthée, aporétique, lent et circonspect, pourrait donc bien, à la fin, offrir le seul nom convenable et sérieux à la philosophie dans les temps où s'accomplit la métaphysique. Comment une collection de philosophie pouvait-elle relever ce nom ? En respectant trois principes. Premièrement, lire (donc parfois éditer, toujours traduire, annoter, commenter) les grands textes de l'histoire de la philosophie, en privilégiant, à chaque époque, les lignes de force qu'imposent le mouvement de la recherche (par exemple, l'étude de Husserl) ou les lacunes de l'édition (ainsi les textes médiévaux, l'idéalisme allemand, les origines de la philosophie analytique). Deuxièmement, accueillir, au-delà de toute préférence personnelle, les ouvrages représentatifs de la philosophie telle qu'elle se fait sérieusement dans la communauté philosophique (depuis la philosophie de la logique, des mathématiques et des sciences, jusqu'aux frontières de l'esthétique et de la théologie) ; d'où la publication de grandes thèses, qui font époque, comme aussi de recueils thématiques, demandés à des chercheurs confirmés ; voire parfois des ouvrages collectifs (actes de colloques, hommages, etc.), pourvu qu'ils marquent un événement théorique. Troisièmement, la confiance lucidement faite à de jeunes penseurs, dont on devine qu'ils deviendront des classiques (car Hyppolite avait su repérer les premiers livres de J. Derrida, G. Deleuze, M. Henry et quelques autres). (fre)
payant
There are no comments on this title.